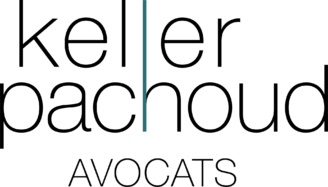Nos actualités
Responsabilité du locataire en cas de non-paiement du loyer
Le bail à loyer d’une surface commerciale a été résilié par le bailleur faute de paiement du loyer par le locataire. Ce congé n’a pas été contesté.
Suite à la résiliation du bail, le bailleur a notamment demandé le paiement d’une indemnité en raison du fait que les locaux n’avaient pas pu être reloués tout de suite.
Le Tribunal fédéral a rappelé que le locataire qui a donné lieu, par sa faute, à la rupture prématurée du bail, a l’obligation d’indemniser le bailleur pour le dommage qu’il lui a causé. Le bailleur peut donc réclamer, à titre de dommage, les loyers fixés contractuellement qu’il n’a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la période qui s’est écoulée entre, d’une part, la fin prématurée du bail, et, d’autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée (au maximum jusqu’à la date à laquelle le contrat aurait pu prendre fin selon le contrat s’il n’y avait pas eu de résiliation pour non-paiement du loyer).
En revanche, le bailleur doit entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour diminuer le dommage de son côté.
Dans cette affaire, le bailleur s’était contenté d’insérer une annonce pour la relocation du bien, une fois par mois et sur un seul site. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le point de vue du Tribunal cantonal : cette action ne suffit pas à admettre que le bailleur a entrepris ce qui était exigible de sa part pour diminuer le dommage. De plus, il est douteux que les locaux aient pu être reloués dans ce cas d’espèce, car des travaux de rénovation avaient dû être entrepris, empêchant probablement la relocation.
Le Tribunal fédéral a également, dans cet arrêt, considéré qu’il appartenait au bailleur d’alléguer et prouver son dommage (lié à la non-relocation des locaux) et qu’il lui incombait donc d’établir que, malgré de réels efforts, il n’avait pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail. En d’autres termes, c’est le bailleur qui supporte le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l’objet remis à bail ne pouvait pas être reloué.
Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2024 en la cause 4A_569/2022 (lien ici)
Recours tardif : difficile d’obtenir une restitution du délai
Un recourant prétend avoir été empêché de déposer son recours devant le Tribunal fédéral en raison d’une incapacité médicale, attestée par un certificat.
Aux termes de l’art. 50 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral), si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers, constitue un empêchement non fautif.
Dans cette affaire, la partie recourante prétendait avoir été empêchée d’agir en raison d’un problème médical l’empêchant de se concentrer; le certificat médical atteste d’ailleurs de ces problèmes de concentration.
Le Tribunal fédéral refuse néanmoins de lui restituer le délai de recours. En effet, il appartenait au recourant d’expliquer de quel type de maladie il souffrait et quelle était l’influence exacte de cette maladie sur ses possibilités d’agir à temps.
L’arrêt relève aussi qu’il n’a pas été démontré qu’il était impossible de demander à un tiers de s’occuper de la défense des intérêts du recourant.
Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2023 en la cause 4A_209/2023 (lien ici)
L’entrepreneur général doit-il remarquer un non-respect des normes de sécurité?
Arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2021 en la cause 4A_570/2020
Une entreprise générale commande à une entreprise spécialisée en la matière des ascenseurs à voiture; le contrat d’entreprise mentionne que l’ouvrage doit respecter les normes de sécurité en vigueur.
Une fois l’ouvrage réalisé, l’entreprise générale émet quelques doutes relatifs à la sécurité des ascenseurs; malgré cela, elle obtient de l’entrepreneur une confirmation selon laquelle les normes de sécurité en vigueur ont été respectées lors de la pose des ascenseurs à voiture.
Suite à une inspection ordonnée par le Département cantonal des constructions, l’entreprise générale apprend, plusieurs mois plus tard, que les ascenseurs à voiture commandés ne sont en réalité pas conformes; il aurait notamment fallu installer des barrières de sécurité à certains endroits.
L’une des questions à laquelle les tribunaux ont dû répondre est celle du moment de l’avis des défauts. L’entrepreneur général, en tant que professionnel de l’immobilier, aurait-il dû se rendre compte des lacunes sécuritaires de l’ouvrage dès qu’il a vu le premier ascenseur à voiture terminé (après tout, l’on remarque facilement si une barrière est présente ou non)? Ou doit-on au contraire partir de l’idée qu’il n’est pas un spécialiste en matière d’ascenseurs à voiture et qu’il est légitime qu’il n’ait pas remarqué qu’il fallait des barrières de sécurité à certains endroits?
Le Tribunal fédéral confirme que le raisonnement des juges cantonaux n’était pas arbitraire lorsqu’ils ont considéré que dans un domaine technique comme celui-là, l’on ne pouvait pas exiger de l’entrepreneur général qu’il remarque le problème malgré les garanties données par le constructeur des ascenseurs. Il était donc admissible que l’avis des défauts n’ait lieu qu’à la lecture du rapport de l’expert mandaté par le Département cantonal, mettant le doigt sur des problèmes de sécurité, et non plus tôt.
Relevons tout de même que la conclusion des tribunaux aurait pu être différente si l’entrepreneur général n’avait pas exigé une déclaration écrite de l’entreprise qui a posé les ascenseurs à voiture au sens de laquelle les normes de sécurité avaient été respectées.
Le bonus : salaire ou gratification ?
Dans un arrêt récent (ATF du 3 mars 2021 en la cause 4A_280/2020), le Tribunal fédéral a rappelé de manière claire (et en français) les trois grandes catégories de bonus qui peuvent exister dans un rapport de travail. Voici ces trois catégories, très schématiquement résumées :
1. Le bonus est considéré comme un salaire variable. Dans ce cas, un montant est déterminé ou objectivement déterminable (sur la base de critères précis tels que le bénéfice, le chiffre d’affaires ou une participation au résultat), donc a été promis par contrat dans son principe et ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur. C’est alors un élément du salaire, que l’employeur doit verser.
Si le bonus est indéterminé ou qu’il n’est pas objectivement déterminable (par exemple il dépend du bon vouloir de l’employeur, ou alors il dépend de l’appréciation subjective de la prestation du travailleur), alors il s’agit d’une gratification et non d’un élément du salaire. Le bonus peut dans ce cas être de deux types différents :
2. Le bonus est considéré comme une gratification à laquelle le travailleur a droit. Telle est la situation si les parties sont tombées d’accord sur le principe du versement du bonus, mais en ont réservé le montant. L’employeur s’engage donc à verser obligatoirement une gratification, mais il a une certaine liberté dans la fixation du montant.
Un bonus est aussi considéré comme appartenant à cette catégorie s’il a été versé sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois ans consécutifs.
3. Le bonus est considéré comme une gratification à laquelle le travailleur n’a pas droit. C’est le cas si les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus. Là, l’employé n’aura aucun droit à obtenir une somme d’argent.
Dashcam : preuve illicite
Un cyclomoteur électrique se fait dépasser par une voiture de manière dangereuse à Lausanne, mais sans que la manœuvre ne provoque un accident. La scène est filmée au moyen d’une GoPro fixée sur le guidon du cyclomoteur.
La question qui se pose est de savoir si le conducteur de la voiture peut être condamné pour infraction grave à la loi sur la circulation routière sur cette base.
Le Tribunal de première instance, de même que le Tribunal cantonal vaudois, ont jugé que les images pouvaient être utilisées et ont condamné le conducteur de la voiture.
Le Tribunal fédéral, lui, est d’un autre avis. Dans un arrêt du 13 novembre 2020 en la cause 6B_1282/2019, il rappelle une jurisprudence récente qui considère qu’en principe celui qui filme les autres usagers de la route sans leur consentement au moyen d’une caméra qui n’est pas clairement visible et qui est allumée en continu (comme une « dashcam ») viole la loi sur la protection des données (6B_1188/2018). Puisque les images sont recueillies de manière contraire à la loi, les images ne sont donc pas exploitables en principe. Ce n’est que si l’infraction commise par la personne filmée est réellement grave que l’on pourrait envisager d’utiliser les images dans la procédure pénale.
L’idée sous-jacente est de laisser à l’Etat la charge de contrôler le comportement des usagers de la route, et non aux particuliers, au risque que ces derniers soient mus par un pur intérêt de « justicier ».
Dans le cas du cyclomoteur, l’infraction reprochée au conducteur de la voiture n’était pas suffisamment grave pour que les images soient exploitables.
Perte de gain maladie et changement de profession
Une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie envoie, le 19 mars, un courrier à son assuré considérant qu’il lui était possible de changer de profession et d’être apte au travail dans une autre activité que celle exercée jusque-là. L’assurance lui annonce qu’elle continuera à verser des prestations jusqu’à la fin du mois d’avril, puis plus rien.
Devant les instances judiciaires, pour justifier ce court délai de transition (19 mars – fin avril), l’assurance avait tiré argument du fait que l’assuré avait déjà, en janvier, discuté de cette thématique (c’est-à-dire le changement de profession) avec l’assurance-invalidité. Le délai aurait donc, selon elle, été suffisant (janvier – fin avril).
L’assuré, lui, a saisi le Tribunal fédéral, considérant le temps imparti pour la transition professionnelle (19 mars – fin avril) trop court ; il a obtenu gain de cause (arrêt du 9 décembre 2019 en la cause 4A_384/2019). En effet, si une assurance attend de son assuré qu’il change de profession, elle doit l’exiger formellement. En l’espèce, l’assurance n’a communiqué clairement que le 19 mars son exigence de changement de profession et elle n’était même pas présente lors de la discussion avec l’assurance-invalidité en janvier.
Au passage, le Tribunal fédéral rappelle que le délai à accorder pour qu’un assuré change d’emploi dans un tel cas est de 3 à 5 mois.